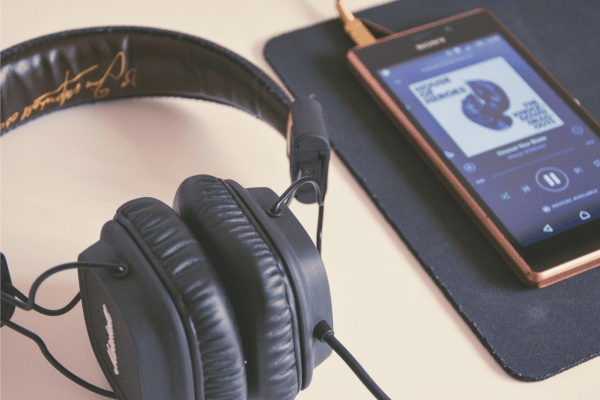Depuis plusieurs mois, des enquêtes — notamment celle de Liz Pelly dans son ouvrage Mood Machine (2025) — révèlent que Spotify insérerait dans ses playlists populaires des titres produits spécialement pour son compte, publiés sous des pseudonymes fictifs.
L’objectif ? Réduire ses coûts de redevances en remplaçant des titres d’artistes réels par du contenu à bas coût.
Quelles sont les possibilités de recours pour les artistes et les labels concernés ?
1. Atteinte au droit moral des auteurs et des artistes-interprètes
Le droit moral, protégé en France, en Suède (pays d’origine de Spotify) et au niveau européen, garantit à l’auteur et à l’artiste le respect de son nom et de sa qualité.
Publier une œuvre sous un faux nom, sans mentionner son véritable créateur ou interprète, peut constituer une atteinte grave au droit moral.
Un auteur ou un artiste lésé pourrait demander :
- La rectification de l’attribution,
- Des dommages-intérêts pour préjudice moral.
2. Remise en cause des contrats de cession
La rémunération des auteurs et artistes doit être proportionnelle. Or, les titres fantômes sont souvent achetés via des contrats de buyout (forfait sans redevances futures), ce qui contrevient à ce principe.
Des artistes et des auteurs pourraient :
- Revendiquer un complément de rémunération,
- Ou même la nullité partielle de certaines cessions passées.
3. Risques de concurrence déloyale et de pratiques trompeuses
Favoriser massivement des “artistes fantômes” fausse le jeu de la concurrence au détriment des vrais créateurs.
Un label ou un artiste évincé des playlists pourrait :
- Agir pour concurrence déloyale, en prouvant une perte d’accès au marché,
- Agir pour imitation de titres existants.
Les consommateurs eux-mêmes pourraient se plaindre d’une information trompeuse, engageant la responsabilité de Spotify sur le fondement du droit de la consommation.
4. Quelle responsabilité pour Spotify en France ?
Bien que Spotify soit une société suédoise, elle doit respecter le droit français dès lors qu’elle cible le public français.
Des actions judiciaires pourraient ainsi être engagées devant les tribunaux français, qu’il s’agisse de :
- Violations de droits d’auteur,
- Pratiques commerciales illicites.
Conclusion
La stratégie des “artistes fantômes” expose Spotify à des risques juridiques réels, à la croisée du droit d’auteur, du droit de la concurrence et du droit de la consommation.
Au-delà du débat éthique, ces pratiques pourraient donner lieu à :
- Des actions en responsabilité,
- Une remise en cause de certains contrats existants.
Dans un environnement numérique en constante mutation, le respect du droit de la propriété intellectuelle reste un enjeu central pour garantir la diversité culturelle et lutter contre l’ubérisation de la création musicale.
Vous êtes concerné·e ? N’hésitez pas à consulter le cabinet via le formulaire ci-dessous.